La CEDH valide l’obligation de localisation aux fins antidopage : tout va très bien madame la marquise ?
Par Jacob Kornbeck*, administrateur du Think tank Sport et Citoyenneté
L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH), prononcé à Strasbourg le 18 janvier 2018, semble conforter le monde antidopage. Selon le journal Le Monde, « l’Agence mondiale antidopage (AMA) peut souffler », le dispositif de localisation des sportifs étant le « pan essentiel de la stratégie de dissuasion des tricheurs ». Alors, tout va très bien madame la marquise ? Oui et non, car il faut bien faire la distinction entre les aspects numériques et non-numériques de la surveillance.
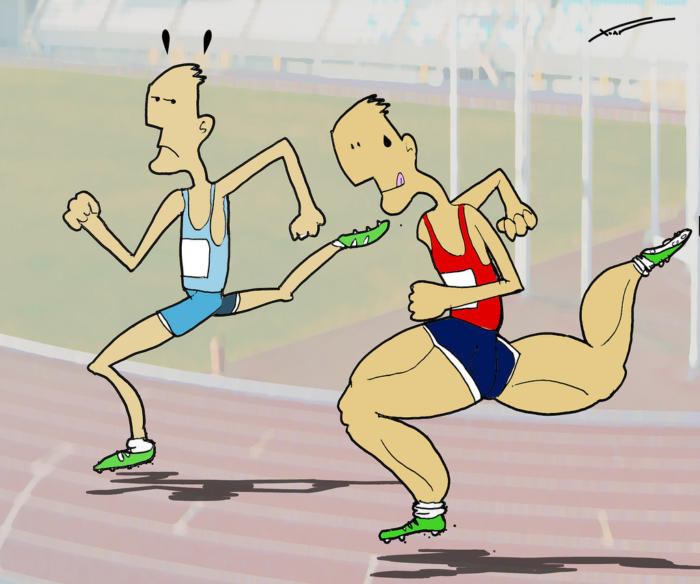
Il s’agit de deux affaires réunies. La requête (Affaire 48151/11) introduite en 2011 par Fédération nationale des associations et des syndicats sportifs (FNASS), avec d’autres syndicats sportifs ainsi que 99 athlètes individuels, visait à faire reconnaître une violation de l’article 8 (droit à la vie privée) de la Convention européenne des droits de l’homme par la France, à travers son ordonnance antidopage n° 2010-379. Idem pour la requête (Affaire 77769/13) d’une cycliste française de haut niveau, introduite en 2013. Au bout de 5 à 7 ans, la Cour a conclu qu’ingérence il y a – car les sportifs ne peuvent manifestement pas exercer leurs droits pleinement – mais que cette ingérence ne constitue pas une violation de la Convention.
La règlementation litigieuse a été jugée « prévue par la loi » comme l’exige la Convention (art. 8 § 2 de la Convention ainsi que « nécessaire dans une société démocratique » (ibidem). La Cour a attaché beaucoup d’importance aux risques que pose le dopage pour la santé des athlètes. L’intérêt général de l’obligation de localisation est déduite des dangers du dopage car « la Cour est convaincue que les enjeux sanitaires et de santé publique en cause dans les présentes espèces, et les légitimes préoccupations d’ordre éthique qui leur sont associées […], fournissent un argument déterminant quant à la nécessité de l’ingérence résultant de l’obligation de localisation litigieuse » (Arrêt, § 177). Ce faisant, elle a cependant méconnu que la règle « 2/3 » du Code mondial antidopage (CMAD) permet à l’AMA d’interdire des substances sans preuve de risques sanitaires (art. 4.3 CMAD). Parmi les critères d’inclusion sur la « liste prohibée » des substances et méthodes, on trouve l’amélioration (présumée ou prouvée) de la performance sportive (art. 4.3.1.1 CMAD), le « risque avéré ou potentiel pour la santé du sportif » (art. 4.3.1.2 CMAD) ainsi que la « détermination par l’AMA que l’usage […] est contraire à l’esprit sportif » (art. 4.3.1.3 CMAD). Les Etats n’ont donc aucune garantie qu’une interdiction concrète soit basée sur un risque sanitaire, et le CMAD permet même d’adopter des interdictions sans preuves scientifiques.
La France peut se féliciter de la validation obtenue, à travers cet arrêt, pour son choix de régime antidopage. Car la CEDH y voit un choix clair et équilibrée : les objectifs de la lutte antidopage ainsi que les droits individuels des athlètes y ont été pris en compte. Cette « réglementation du dispositif de localisation décidée par les autorités françaises offre un cadre légal à la lutte antidopage qui ne saurait être sous-estimé du point de vue des garanties des droits des sportifs concernés », avec « un cadre apte à garantir que les sportifs soient à même de contester leur désignation dans le groupe cible, y compris par une voie de recours juridictionnelle […] Elle leur permet également de prévoir et d’adopter leur conduite au regard des lieux et des moments fixés pour les contrôles […], un contrôle manqué étant limité à leur absence au lieu et à l’heure indiquée par eux […]. Elle leur ouvre, enfin, la possibilité de contester les sanctions infligées devant la juridiction administrative » […] (Arrêt, § 187). La France a donc agi en bon État de droit – et elle a le droit d’en être fière.
Seulement, voilà : deux droits différents et distincts y sont concernés : à savoir les volets numérique et non-numérique de l’article 8 de la Convention. Car si la Charte de l’Union européenne sur les droits fondamentaux connaît un droit à la vie privée (article 7 de la Charte) et un autre à la protection des données (article 8 de la Charte), la Convention n’en connaît qu’un. Et l’arrêt ne dit presque rien sur le traitement informatisé des données personnelles, ce qui représente un enjeu bien plus grand, surtout dès le 25 mai 2018, date à partir de laquelle le règlement général « Protection des données » de l’Union européenne[2] sera entièrement applicable.
* Auparavant en charge des questions antidopage au sein de l’Unité Sport de la Commission européenne (2001-14), Jacob Kornbeck est fonctionnaire européen et chargé de cours externe à l’Université allemande du Sport de Cologne. Les opinions exprimées sont strictement personnelles et ne sauraient aucunement engager les institutions de l’Union européenne.










 ADHÉRER
ADHÉRER CONTACT
CONTACT FACEBOOK
FACEBOOK